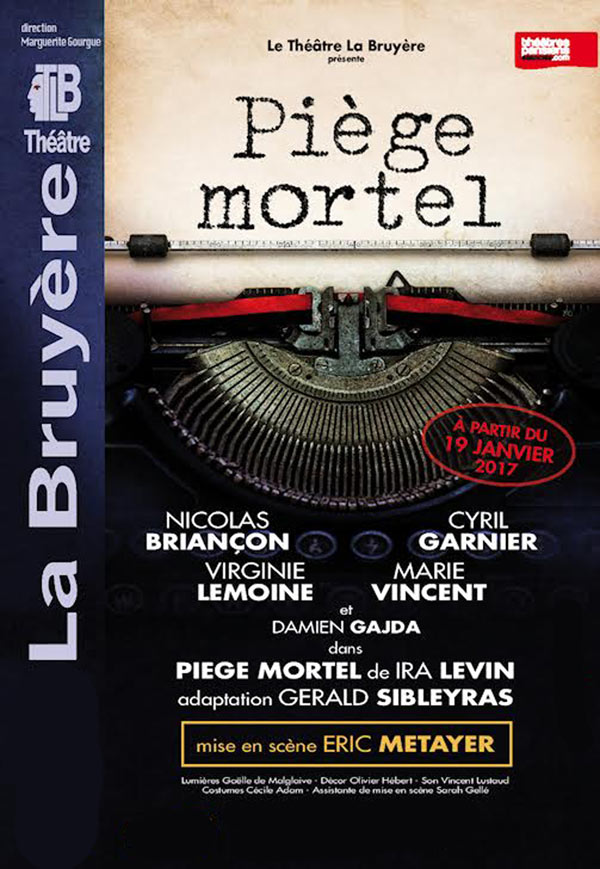Cet entretien a quelque chose de très symbolique pour moi. Pas seulement parce qu’il signe le retour de ce format après plus de 3 ans d’absence. Pas non plus parce que c’est le premier comédien que j’interroge qui ne vient pas de la Comédie-Française. Non, si cet entretien est très particulier pour moi, c’est que je me souviens bien du jour où Gladscope a publié un entretien avec Nicolas Briançon. Devant mon enthousiasme (et, avouons-le, ma jalousie), elle me proposa alors de nous mettre en contact. Trop intimidée, je déclinai aussitôt : je n’étais pas prête. Me voilà, cinq ans après, la même admiration pour ce comédien chevillée au corps, et prête à le rencontrer. Mood : gamine de 5 ans.
Nicolas Briançon est pluriel. Dans ce monde où tout doit rentrer dans des cases, difficile de le classer : il accumule les casquettes – comédien, metteur en scène, directeur de Festival – mais également les styles – ainsi, on trouvera sur son parcours Shakespeare, Kundera, Molière, Ben Jonson, Marcel Aymé, Sacha Guitry, mais aussi Canal + pour lequel il a tourné deux séries. Avec son Le Canard à l’Orange de William Douglas Home, actuellement à la Michodière et qui rencontre un vif succès, il rétablit la noblesse du genre. Rencontre avec un transformiste du verbe et de la prose…
MDT : Pouvez-vous vous décrire en trois mots ?
Nicolas Briançon : 56 ans, comédien, parfois metteur en scène.
Comment en êtes-vous venu au théâtre ?
Je suis d’une famille assez bourgeoise, mon père était magistrat, on déménageait tous les 5-6 ans. Mon adolescence est à Bordeaux, mon père est prof à l’école de la magistrature, j’ai beaucoup d’admiration pour lui mais il n’est pas très présent pour des tas de raisons. Je ne sors pratiquement jamais avec lui. Et un jour il m’emmène au cinéma voir La flûte enchantée de Mozart que Bergman avait tournée. Mon père a fait deux choses dans sa vie : il m’a amené au cinéma et il m’a mis dans les mains un bouquin de Michel Déon qui m’a ouvert de nombreuses portes. Alors est-ce que c’est parce qu’il a fait si peu pour moi que j’ai accordé beaucoup d’importance à ce qu’il m’a donné, ou est-ce qu’il est tombé juste, je ne sais pas. Le fait est qu’à cette époque, je n’écoute pas de musique classique, je ne suis jamais allé au théâtre, et là il se passe quelque chose comme dans les films : il y a un avant et un après. Je sors de la séance complètement époustouflé par ce que j’ai vu. Je me rends compte qu’il y a là un autre monde beaucoup plus intéressant que le vrai. Et donc je commence à creuser un peu, je vais à l’Opéra de Bordeaux et je loue des 33 tours d’opéra que j’écoute en boucle chez moi. À force de zoner dans cette médiathèque, Gérard Boireau, le patron de l’Opéra de l’époque, me repère et me propose de faire de la figuration. Et me voilà parti pour faire un jeune garçon qui accompagne Falstaff partout. Falstaff, c’était une star qui s’appelait Gabriel Bacquier. Je découvre le théâtre, les rideaux, le lieu, l’endroit absolument magnifique – d’autant que l’Opéra de Bordeaux c’est peut-être le plus beau théâtre du monde et un endroit extraordinaire pour un enfant. Et c’est le moment où je me suis dit : je vais vivre dans un théâtre. Il y avait un truc que j’adorais, c’était le dimanche. Chez moi, c’était une vraie source d’angoisse : promenade en forêt, gigot d’agneau, millefeuille, et ennui apocalyptique. Et voilà que ça devenait synonyme de répétitions et de matinée : j’avais l’impression de sauver ma journée. Très vite, Bacquier, qui m’avait pris sous son aile, m’a dit « ne fais pas chanteur, c’est un métier de merde. Sois comédien ! ». Voilà comment, parallèlement à mes figurations à l’Opéra, j’ai commencé à aller zoner au cours de théâtre de mon collège où j’ai très vite eu un petit succès. Je me disais que c’était quand même génial ce boulot qui faisait que, tout d’un coup, les gens s’intéressent à vous – j’avais toujours été un enfant plutôt discret. Je suis allé m’inscrire au Conservatoire de Bordeaux, où j’ai été pris, j’ai passé mon bac, mais je n’arrivais pas à me dire que j’avais la légitimité d’être acteur. Et puis après mon bac, mon père a été muté aux Antilles, et comme il était hors de question que j’aille faire mes études supérieures là-bas, il a été décidé que je monterai à Paris. Je me suis inscrit à la fac, je n’ai jamais été en cours, et la vie a commencé comme ça.
Racontez-nous votre histoire avec le théâtre.
J’ai la chance de vivre de mon métier. En réalité, j’ai toujours eu cette chance, simplement je me suis beaucoup laissé porter au début : je travaillais, on m’engageait, je me posais assez peu de questions sur ce métier. J’étais libre, c’était marrant et payé, donc je le faisais. En fait j’ai commencé à me poser des questions quand j’ai fait un spectacle qui a été très marquant. Mais il faut que je retourne longtemps en arrière pour raconter ça.
Au tout début de ma carrière, je suis parti dans une compagnie en province parce que j’avais du mal à être à Paris, ce qui signifiait alors prendre des cours et ne pas jouer. Avec une bande de potes, dont étaient déjà Nicolas Vaude et Eric Laugérias, on avait monté Volpone dans les campagnes du Berry et du Sud-Ouest. C’est là que Roger Louret, qui avait une troupe dans le Lot et Garonne, est venu voir le spectacle, et nous a proposé de venir jouer en septembre, ce qu’on a accepté. J’ai déboulé dans ce village de 900 habitants où il y avait cette troupe de théâtre, et où ma jeune première – c’est pour dire l’expérience théâtrale complètement dingue – c’était Muriel Robin. Je suis resté trois ans dans cette troupe – c’était vraiment le Capitaine Fracasse : on jouait dans des salles des fêtes, sur des planches de contreplaqué posées sur les tables d’école, c’était fou – puis je suis rentré à Paris parce que je suis tombé amoureux d’une fille. A cette époque, j’ai bossé au Français sous Le Poulain. J’ai joué avec Roland Bertin dans Turcaret de Lesage, dans une mise en scène de Yves Gasc. C’est à ce moment qu’Hervé Van der Meulen, l’assistant d’Yves Gasc de l’époque, m’a proposé de prendre sa place en tant qu’assistant de Jean Marais, car il ne pouvait pas le faire. J’accepte et, quand je rencontre Jean Marais, j’étais déjà devenu assistant de fait, il me présentait son travail, ses idées, etc. Au bout de vingt minutes de discussion, il me demande si ça m’amuserait de jouer le rôle de Bacchus, dans la pièce du même nom qu’il montait. Le spectacle a été créé au Festival d’Anjou, puis repris aux Bouffes Parisiens chez Brialy. C’est là que j’ai commencé à jouer, vraiment jouer ; j’ai enchaîné des Festival, des comédies, des théâtres parisiens. J’ai enquillé, enquillé, enquillé, en ne me posant aucune question. A ce moment, Louret, qui avait présenté à Paris un très bon spectacle musical sur les années 40, La Java des Mémoires, me propose de participer à celui à venir, sur les années 60. J’ai suivi, et je me suis retrouvé dans ce spectacle qui s’appelait Les années Twist. Personne n’y croyait, et nous voilà pourtant programmés au Palais des Sports. Succès critique incroyable, mais on ne fait que 2000 personnes par soir sur les 4000 que peut accueillir la salle, donc on se prépare à s’arrêter au bout d’un mois, comme prévu. C’était sans compter Gérard Louvin, le Monsieur TF1 de l’époque – on était en 1995, qui est venu voir le spectacle 2 jours avant qu’on termine, et qui s’est indigné de ce que le spectacle ne soit pas repris à Paris ! Le lendemain, on avait au garde-à-vous les anciens propriétaires de la Porte Saint-martin, des Folies Bergères, et du Cirque d’Hiver. Et c’était le début de 5 ans de tournée, d’abord aux Folies Bergères, puis en Province, puis à nouveau aux Folies Bergères… C’était génial, on vivait tous ensemble : on est tous arrivés mariés dans ce spectacle, on en est tous sortis divorcés ! Jusqu’à cette période-là, c’est la vie qui m’a promené à travers les spectacles. C’est vraiment avec les Années Twist, et mon travail en tant qu’assistant de Louret, que j’ai commencé à m’intéresser à ce que je faisais vraiment et au sens que ça avait. Et quand j’ai vu arriver la fin du spectacle, je me suis posé sincèrement la question de la suite. Le paradoxe, c’est que le succès, quand il dure vraiment, il isole. Pendant 6 mois, vous êtes le roi de Paris, et puis la deuxième année, les copains, le métier, tout le monde est globalement venu vous voir, la troisième année se passe, la quatrième année on commence à se demander où vous êtes et ce que vous faites alors que vous jouez toujours dans le même spectacle ! C’est vraiment à ce moment que j’ai commencé à me poser les questions que j’aurais peut-être dû me poser bien en amont. Et j’en ai tiré trois réponses : d’abord, que je n’avais pas envie de n’être que dans le désir des autres. Ensuite, que j’avais franchement envie de revenir aux auteurs même si cette expérience de théâtre musical m’avait beaucoup amusé. Et, enfin, que c’est un métier où, si on veut être vraiment libre, il faut bosser, et bosser vraiment. Je ne pouvais donc pas continuer à être cette espèce de chose ballotée par les circonstances.
Je me suis rappelé un souvenir de fin d’adolescence : j’avais vu la création de Jacques et son maître au théâtre des Mathurins, j’étais sorti en me disant « Je veux jouer ce truc-là ». Donc je me suis dit que c’était bien pour commencer cette nouvelle période de ma vie – on est à la toute fin des années 90, j’ai rameuté des copains et j’ai décidé de monter des pièces dans le théâtre de Louret. Et ça a été le début d’une certaine boulimie : j’ai monté quatre spectacles en quatre mois. Je montais un spectacle, je commençais à le jouer et en parallèle je mettais en répétition le suivant, etc. Jacques et son Maître a bien marché, on a fait une présentation à Paris et on a été pris au Théâtre 14, ça a été très vite un succès critique et public, puis on est allé à la Madeleine, à l’Hébertot, et jusqu’aux Molière où j’étais nommé. Et c’était reparti, en fait. Mais c’était reparti mieux, c’était reparti du bon pied. J’ai commencé à mettre beaucoup en scène et à faire un peu moins l’acteur car je me disais qu’il faut être sérieux, on ne peut pas mettre en scène et jouer. Bullshit ! A un moment, j’en ai eu marre, car j’ai mis en scène des acteurs dans des rôles que j’aurais pu jouer, et quand ils jouaient je me disais que j’aurais pu le faire mieux. Je voulais beaucoup jouer Trahisons de Pinter et je me suis empêché de le mettre en scène en même temps, donc j’ai demandé à Léonie Simaga de me mettre en scène. Et puis j’ai continué, parfois à jouer, parfois à ne pas jouer. Léonie m’aidait souvent : je mettais en scène et je demandais à Léo de venir une semaine pour s’occuper de moi, de mon rôle. C’est elle qui m’a remis dans le droit chemin pour Volpone en me disant que ce n’était ni Jacques et son maître, ni Scapin. C’est elle qui m’a dit de garder les mains liées dans le dos pendant toute la pièce pour jouer Mosca ; je me souviens qu’elle me disait « joue-le couleur des murs – il n’y a qu’au dernier acte, à la dernière scène, qu’il sort du panier ». De temps en temps, une phrase comme ça vous éclaire vraiment sur un rôle, beaucoup plus que des milliers d’explications. Les grands directeurs d’acteur sont ceux qui trouvent peu de mots, très simples, pour vous éclairer.
Aujourd’hui, ce que je retiens de la première partie de ma vie d’acteur, c’est une forme de liberté que j’essaie de toujours conserver dans mon travail, une certaine liberté de choix, de ne pas rester là où on m’imagine. C’est pour ça aussi que le Festival d’Anjou m’a beaucoup aidé : il m’a obligé à m’intéresser au travail des autres – il fallait vraiment que je sache ce qui se faisait. Ça m’a fait grandir. Je me suis beaucoup enrichi de voir des méthodes de travail différentes, de voir des esthétiques différentes, qui vont parfois à l’encontre de ce que je peux faire ou dire mais toujours très intéressantes à observer – ne serait-ce que pour préciser parfois ce qu’on n’a pas envie de faire. Je suis devenu aussi beaucoup plus tolérant : maintenant j’ai très bien accepté l’idée qu’on pouvait faire très différent de moi et que ça pouvait être formidable. Je pense qu’il y a très peu de metteurs en scène qui acceptent cette idée – il faut savoir que les metteurs en scène, lorsqu’ils vont voir une pièce, pensent toujours simultanément à la mise en scène qu’ils auraient, eux, proposée – et évidemment ils auraient toujours fait mieux !
J’aborde la dernière partie de ma vie très joyeusement : je suis concentré sur l’idée de prendre du plaisir. Je crois que le théâtre se relèvera toujours de tout. Tant qu’il y aura un type qui écrit et un type qui a envie de dire le texte, ça existera. Mais c’est vrai qu’il y a une petite montée de l’amateurisme qui me chagrine. Je n’irais pas jusqu’à évoquer la prédiction de Michel Bouquet qui, en parlant du théâtre, dit que ce ne sera bientôt plus qu’un divertissement joué par des amateurs. Je trouve qu’il y a une tendance à l’avignonnerie. Et je suis las de ceux qui montent sur les planches sans avoir rien à y faire. Un chanteur qui tout d’un coup a envie de jouer, je comprends. Un mec qui vient du one, aussi. Mais ceux qui viennent de la télé réalité, par exemple, n’ont rien à faire là. On est un peu dans le « ça va marcher parce qu’il ou elle est connu ! ». Mais le théâtre, ce n’est pas ça. C’est un peu affolant.

On vous a vu il y a des années dans des théâtres municipaux. Aujourd’hui, Nicolas Briançon rime avec théâtre privé. Quel regard portez-vous sur ce constat ? Et, de manière plus générale, sur le clivage entre théâtre public et théâtre privé ?
J’adorerais travailler dans le théâtre public. Mes grandes émotions de théâtre, je les vois au Théâtre Public. J’ai eu un Dieu du théâtre, c’était Strehler. J’ai vu tous les spectacles de Strehler à Paris depuis que j’étais en âge de les voir, j’ai pleuré devant tous ses spectacles, souvent de joie ! J’ai eu aussi des joies dans le privé : Poiret dans Joyeuses Pâques reste pour moi un modèle – d’ailleurs, quand j’ai fait Le Canard à l’Orange, c’était dans l’idée de rendre hommage au Théâtre de boulevard mais aussi à Poiret. Ces gens-là sont parvenus à me donner l’impression que tout s’inventait devant moi au présent : et c’est ça qui embarque le spectateur. Chez Strehler, on avait l’impression que tout surgissait devant nous.
Aujourd’hui, j’ai l’impression que les barrières public/privé s’estompent en ce qui concerne les comédiens : ils passent plus facilement de l’un à l’autre. Le public a besoin de ses stars de temps en temps : ils vont chercher Karin Viard, Marina Foïs, Pierre Arditi, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart… ils ne rechignent pas non plus à la tête d’affiche ! Ce qui est dommage, c’est que l’ouverture ne s’est faite que d’un côté : le théâtre privé s’est largement ouvert au théâtre public, et c’est génial. Par exemple, j’aime l’idée que Joël Pommerat ait la possibilité de montrer son spectacle à d’autres gens que la petite sphère d’aficionados classiques. Ce sont vraiment des spectacles qui s’adressent à tous, pas seulement au petit clan de profs de lettres de la région parisienne. Mais de l’autre côté, je trouve que de temps en temps, il y a des productions dans le privé qui pourraient, en tournée, se retrouver dans des Scènes Nationales et ça n’arrive jamais – y compris avec des spectacles comme Jacques et son Maître. Pourtant on pourrait se dire que Diderot, Kundera, monté sans star et avec une vraie équipe d’acteurs, ça aurait sa place dans une Scène Nationale ! Mais non, on n’en a pas fait une seule, simplement parce qu’on a joué au départ au Théâtre de la Pépinière. Alors bon, on s’en fout, c’est pas très grave, mais on sent qu’il y a cette méfiance qui subsiste, d’un côté comme de l’autre.
Le théâtre privé va mal. Je ne suis pas contre les groupes qui récupèrent les théâtres. Par exemple quand Fimalac garde Jean Robert-Charrier à la Porte St Martin, c’est très bien. Quand il laisse faire en son nom des gens qui sont plus des ferrailleurs que des directeurs de théâtre, c’est un très mauvais choix. Je pense qu’à l’arrivée il faut que les théâtres soient gérés par des gens qui sont des gens de théâtre, et pas par leurs propriétaires. Un théâtre a besoin d’une identité et d’une âme. Un petit objet comme le Poche-Montparnasse fonctionne parce qu’il ont su créer une âme – on peut adhérer ou non à la programmation, mais il y a quelque chose qui se passe quand on rentre dans cet endroit-là. Et puis il y a d’autres endroits où on ne sait pas où on est. Quand je parlais tout à l’heure d’une forme d’amateurisme, je parle aussi de ça.
Je pense que c’est très important d’avoir le théâtre public. Je suis très content par exemple que la Comédie-Française touche beaucoup d’argent. Mais je pense aussi que le Français a besoin d’une réforme de ses statuts – ce que personne ne fera puisque vu la tendance en ce moment, il n’y a pas un gouvernement qui va aller foutre le merdier dans un endroit qui fonctionne à peu près et qui ne pose pas de problèmes. Mais que des gens touchent des bénéfices sur de la subvention, je trouve que ça n’a pas de sens. Que des comédiens soient virés par d’autres comédiens, c’est horrible. Ce système est pourri : on devrait donner un ou deux ans de sa vie au Français et après aller voir ailleurs. J’adorerais voir André Dussollier dans un très grand rôle au Français par exemple, pourquoi nous empêcher de voir ça ? A la Royal Shakespeare Company, ils ne s’emmerdent pas avec ça.
Alors évidemment, quand on y va de la comparaison avec les Anglais, on voit émerger plein de problèmes chez nous ! Par exemple, l’un des problèmes du théâtre privé, c’est que les grandes stars – ces gens qui remplissent les salles sur leur nom – au lieu de profiter de leur notoriété pour se mettre à la tête d’aventures théâtrales un peu ambitieuses, font des merdes à deux pour récupérer un peu plus d’argent sur les recettes. Mais mince quoi : il ne vous serait pas possible de jouer un grand texte, d’avoir un peu une ambition au lieu d’avoir toujours l’ambition du fric ? Là on est dans un vrai problème. Je mets de côté Pierre Arditi qui, de temps en temps, prend des risques, comme lorsqu’il va faire un spectacle avec Didier Bezace : il fait des allers retours. Il y en a quelques uns comme ça. Mais le reste… quelle honte ! J’ai vu Kevin Spacey à Londres dans Richard III ; il y avait deux loges, une pour les filles et une pour les mecs, et il n’avait aucun traitement de faveur. Il était avec les autres acteurs, il devait gagner 1000£ par semaine et je peux dire qu’il ne jouait pas au rabais ! Il faut qu’on s’y mette aussi : le théâtre n’est pas qu’un endroit pour faire du pognon quand on est connu. Il y a un vrai problème de conscience chez nos élites d’acteurs : qu’ils aillent de temps en temps au théâtre pour gagner du blé, ok, c’est aussi un métier et il faut gagner son pain. Mais il faut aussi savoir prendre des risques. Quand je vais au théâtre à Londres, je vois des grands acteurs dans de vrais projets avec de vraies aventures de théâtre, ambitieuses – parfois ratées, peut-être, mais il y a quand même une ambition de fond. Chez nous, il y a quand même un souci. Et il y a aussi un manque d’ambition généré par les medias : aujourd’hui on n’a plus une seule émission qui parle de théâtre à la télé. Comment ça se fait que le service public n’ait pas une émission mensuelle sur le théâtre, les sorties du moment, et qui ne soit pas une émission où on cherche toujours le buzz en mettant toujours des critiques, un qui est là pour aimer et un qui est là pour foncer dans le tas… je suis un peu fatigué de tout ça.
Allez-vous souvent au théâtre ?
J’essaie, sauf évidemment dans les périodes où je joue tous les soirs. Là par exemple je suis beaucoup allé au théâtre entre septembre et janvier parce que j’étais en tournée avec le Guitry. D’ailleurs j’ai vu des trucs plutôt pas mal, y compris des spectacles souvent massacrés par la critique. Par exemple, Scorpios au loin, qui a été descendu en flamme par tout le monde – je ne peux pas dire que la pièce m’ait anéanti d’étonnement et de bonheur, mais j’ai quand même trouvé qu’Arestrup était extraordinaire. Il y a très peu d’acteurs français capables de faire ça : une vraie composition à l’anglo-saxonne avec une transformation sans perruque, sans maquillage, sans rien, mais on ne voit plus l’acteur, on voit Churchill. J’ai passé ma soirée à le regarder vivre ce truc-là. Je trouve que ça n’a pas été beaucoup souligné dans ce que j’ai lu – après on est dans une pièce de genre qui tombe dans les écueils qu’on connaît et qu’on peut deviner avant de voir le spectacle, mais ça reste un acteur formidable.
Qu’est-ce que le boulevard ? Pourquoi monter des boulevards aujourd’hui ?
Le boulevard, c’est Joyeuses Pâques de Jean Poiret. Dans ma petite mythologie personnelle, ça a toujours été ça, c’est-à-dire une qualité d’écriture, une efficacité, et surtout la capacité pour les acteurs de jouer une vraie situation. Pour Le Canard à l’Orange par exemple, le premier truc qu’on s’est dit c’est qu’il fallait prendre la situation au sérieux, qu’il ne s’agissait pas d’aller au comique tout de suite. Sur certaines répliques, on a de vrais moments hors du rire : quand Anne me dit qu’elle part, dans la scène d’introduction, je ne m’interdis rien – si je veux placer un vrai silence, je le mets. C’est important de ne pas se dire qu’il faut aller au rire à tout prix, toutes les secondes. Ce n’est pas un théâtre qui est fait pour ça. En fait, je n’ai pas eu l’impression de traiter ce théâtre-là différemment que La nuit des rois ou toute autre pièce, si ce n’est qu’il faut y glisser à un moment donné une forme de jubilation. On doit sentir que les acteurs sont heureux de jouer ça. C’est là la vraie différence : on laisse transparaître quelque chose qui est de l’ordre du bonheur pur du jeu. Peter Brook termine L’espace vide en disant « Jouer est un jeu ». C’est une phrase qui revient dans ma vie constamment : il faut que le théâtre reste un jeu. Dans ce théâtre-là, comme dans Feydeau d’ailleurs, il y a quelque chose de l’ordre du plaisir de jeu qu’on doit laisser passer, montrer, et presque mettre en scène aussi tout en restant dans la situation et dans ce qui se joue à un moment précis. En ce sens – et ce n’est pas du tout pour défendre le boulevard en citant des grands noms ! – Chéreau disait que « le théâtre de boulevard est la seule histoire de théâtre qui existe en France, hélas ». Les Anglo-saxons ont le théâtre Elisabethain, les Italiens ont la Commedia dell’arte. Nous on a le théâtre classique mais il est directement inspiré des Grecs, et, la vraie invention, c’est le vaudeville. L’invention des Français, c’est les maris cocus, les femmes trompées et les amants dans le placard. C’est un genre en soi qui mérite qu’on s’y intéresse, qu’on le traite sérieusement – en tout cas avec respect et honnêteté.
Vous avez été dans les starting blocks pour racheter le Théâtre de l’Atelier avec Nagui. Pourquoi lui ? Envisagez-vous un autre rachat ? Pour quelle raison posséder un théâtre aujourd’hui ?
Clairement, j’ai refusé cette idée pendant longtemps. Et puis il y a eu Anjou ; j’arrête le Festival d’Anjou cette année, je pense que 16 ans c’est le bon moment, on fête les 70 ans du festival et j’ai dit ce que j’avais à dire avec ça. Maintenant, ça m’amuserait d’animer un lieu – ce serait très différent d’Anjou évidemment mais je pense que si j’ai réussi un truc dans ce Festival, en 16 ans, c’est d’y créer une âme. Je crois que ça, précisément, je saurais le faire, et je pense que c’est ce qui manque dans les lieux. Ça ne veut pas dire que je ne me planterai pas ! Ça, c’est la vie du théâtre. Mais j’ai toujours fait autre chose que jouer, et, même si je pense que l’acteur c’est la base, et que c’est la dernière chose que je garderais si je devais tout lâcher, cette envie de faire vivre un lieu m’anime de plus en plus. Alors évidemment, je suis tributaire de quelqu’un qui achète un théâtre et qui a envie de me le confier. Nagui, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup, et dont je trouvais les raisons qui le poussaient à acheter un théâtre vraiment géniales, belles, par rapport à la langue française, à sa mère, à son éducation. Sa démarche me paraissait extrêmement intéressante et je pense que c’est quelqu’un avec qui je peux m’entendre très bien. Si l’occasion devait se représenter et qu’il était toujours partant de le faire avec moi, je serai de la partie !
Après, il y a un juste milieu à trouver. Avoir un théâtre et ne pas être dedans, je ne vois pas l’intérêt, mais y être tout le temps serait une erreur. Je pense que l’un des problèmes qu’on rencontre aujourd’hui dans certains théâtres privés c’est le manque d’âme, d’identification du lieu mais aussi d’identification directe avec quelqu’un. Un directeur de théâtre est là pour incarner la fonction. Je le vois bien à Angers, j’ai un rapport presque charnel avec ce travail là : je suis là tous les soirs, je parle avec les gens, j’entends les retours. Mais évidemment il ne s’agit pas d’y proposer cinq spectacles de Briançon dans la saison !

Vous laissez le Festival d’Anjou aux mains de Jean Robert-Charrier. Quel bilan sur votre mandat ? Quels espoirs et quelles craintes pour son futur ?
C’est un excellent choix : Jean, dans son genre, c’est un très bon. Je n’ai pas à rougir de mon mandat : je laisse un bilan comptable excellent, on est passé de 20 000 à 26 00 spectateurs, on a fait exploser les recettes, on est passé de 15 représentations à 28, on a développé les partenariats privés, on a considérablement changé le public, on a créé le concours des compagnies… Sans aucune langue de bois, il y a une équipe sur place absolument géniale. Cette équipe, qui bosse à l’année, est vraiment ultra compétente. J’incarne le Festival en faisant les choix artistiques mais je n’oublie pas l’équipe qui est derrière.
Moi, comme je suis très orgueilleux, je voulais partir quand c’était bien. Et puis j’ai assez gueulé contre mes confrères qui dirigent des institutions culturelles et qui hurlent comme des gorets quand on les déplace de l’Odéon à Avignon ou qui trouvent scandaleux que, après avoir pendant 50 ans dirigé un Centre Dramatique National, on leur demande poliment de laisser la place à des gens plus jeunes… on n’est pas propriétaires, et surtout pas des institutions publiques ! D’ailleurs, j’ai une théorie sur le théâtre : ceux qui possèdent des théâtres, notamment des théâtres privés, ne sont pas les réels propriétaires des lieux. Si j’ai déjà joué dans un théâtre privé et que j’y retourne, c’est chez moi. Je serai toujours plus propriétaire de ce théâtre que son propriétaire. C’est un truc que les directeurs de théâtre ont du mal à comprendre mais c’est une réalité que je sais partagée par tous les acteurs. Les lieux appartiennent aux artistes. Et, à un moment, les propriétaires sur le papier doivent les rendre. A Anjou, je suis arrivé au bout de l’invention que je pouvais avoir, de l’énergie que je pouvais y mettre et c’est bien que quelqu’un d’autre arrive, qui va faire quelque chose de fondamentalement différent.
Je me disais qu’il était encore temps de passer à autre chose, que j’avais aussi assez d’énergie pour partir vers de nouvelles aventures. Et puis la période d’été regroupe aussi beaucoup de tournages que j’ai été obligé de refuser ces dernières années à cause du Festival, et j’aimerais bien me laisser la porte ouverte à des propositions, qui arrivent de plus en plus nombreuses, ce qui me réjouit.
Vous êtes un personnage important de la série Engrenages sur Canal +. Comment appréhendez-vous votre travail à la télévision ? Cela demande-t-il un travail différent pour le comédien ?
J’ai été fan d’Engrenages avant de jouer dedans. J’ai découvert la série un été alors que je vivais entre le cendrier, le canapé et la casserole de pâtes. J’ai dévoré le DVD de la saison 1 en 48 heures. J’ai appelé mon agent pour lui dire que je voulais arrêter de tourner des merdes et qu’il fallait que je tourne dans une série de Canal. Je lui lançais un challenge, elle adore ça. Il faut dire que jusque-là j’ai toujours eu du mal à prendre mes tournages au sérieux ; j’ai toujours eu l’impression de partir en vacances quand je tournais. J’ai passé des essais pour Maison Close six mois après, ce qui m’a permis de rencontrer des gens de Canal à qui j’ai dit que je voulais absolument passer dans Engrenages, même si ce n’était que pour une scène. Et puis ils m’ont appelé pour passer des essais pour la saison 4, ils m’ont bien aimé donc j’ai participé à toutes les saisons jusqu’à la dernière. J’aime beaucoup les séries, et j’aimerais beaucoup en refaire une – mais une bonne. Et puis, juste pour rêver, il y a trois séries étrangères que j’aurais adoré faire : House of Cards, Succession, et Game of Thrones. Succession c’est un peu la série qui me fait dire en France « hé ho, les acteurs, travaillez, donnez-vous du mal ! » C’est là qu’on voit qu’on a un énorme problème de formation chez nous. C’est dingue le manque de souplesse et de maniabilité des comédiens français. Ce n’est pas un hasard si les acteurs anglais sont les meilleurs du monde. Ok, tous leurs spectacles ne sont pas des chefs-d’oeuvre de vision, de mise en scène, mais les acteurs sont toujours au rendez-vous. Les acteurs sont dingues, et pourquoi ? Parce qu’ils bossent. Et qu’ils ont un tronc commun de formation : ils apprennent la même chose dans tous les cours. En France, n’importe qui peut mettre sur sa porte « prof de théâtre », et il le devient. Moi, je serais drastique : je suis pour le carte professionnelle. Ce n’est pas une affaire de diplôme, mais de cooptation. Les artistes anglais sont cooptés, ils ont deux parrains : si le jeune comédien n’est pas à l’heure, s’il ne sait pas son texte, s’il est bourré, c’est eux qu’on appelle. Et si tu n’as pas ta carte professionnelle, tu ne travailles pas.
Êtes-vous tenté par d’autres activités au sein de la culture ?
J’aimerais beaucoup mettre en scène un opéra mais je ne sais pas comment faire. Je vois le temps passer, et je ne le fais pas. Je voudrais monter les Noces de Figaro, mais c’est un petit milieu, trusté, dans lequel il est très compliqué de rentrer, et je ne suis pas sûre d’avoir des portes à pousser pour le moment. C’est aussi mon problème : moi, on ne sait pas trop où me mettre. Je fais Le Songe, Volpone, Engrenages, Le canard à l’orange. Je ne suis pas dans les cases. Je sais que l’Opéra viendra, mais je ne sais pas encore comment. Ce serait l’échec de ma vie si ça ne se faisait pas.
L’ère MeToo, ça a changé quelque chose pour vous ? Pour la profession en général ?
Moi, j’ai commencé très tôt à bosser avec des homos… en forme. J’étais assez mignon quand j’avais 25 ans, et ils étaient présents. Je ne l’ai pas vécu comme du harcèlement, d’abord parce que mes choix sexuels étaient très clairs, et puis j’avais quand même 25 ans donc je n’étais pas dans une zone d’hésitation majeure et ils ne me faisaient pas peur – j’ai toujours pris ça à la rigolade. Il faut s’imaginer Le Poulain me faisant signer mon contrat dans le bureau d’administrateur tout en me disant « C’est génial, on a besoin de jeunes dans la troupe en ce moment – touche ma bite en parlant » … ! Mais je ne me suis jamais senti menacé par ces mots, je n’ai jamais eu peur, j’ai adoré ces gens là et je me suis toujours marré avec eux. Ça c’est une chose. Après, l’autre chose qui existe et que je n’ai jamais vécue, c’est le vrai harcèlement pendant le travail. Chez moi, bosser avec quelqu’un me coupe quelque chose dans ma libido, que ce soit avec des actrices ou des élèves. La relation de dépendance que ça crée vis-à-vis de moi est absolument anti-érotique. D’abord, c’est peut-être de l’orgueil mais je n’aimerais pas me dire que c’est de ça dont dépend ma relation à l’autre, ce serait quand même assez bas. Moi si on m’aime c’est parce que je suis extraordinaire ! J’ai été épargné en fait par cette tentation que d’autres ont vécue, et qu’on peut comprendre intellectuellement : on bosse avec des femmes très belles, très brillantes, très sexy, ça pourrait glisser. Mais je suis hors de ça. Si le mouvement a pu recadrer un certain nombre de faux pas, je le trouve extrêmement sain, et il était temps. Je suis un féministe acharné sur le plan de la parité des salaires, de l’égalité profonde entre les hommes et les femmes, j’ai même plutôt du mal à comprendre que ça puisse être différent. Maintenant, je ne peux pas être dans une approche qui serait une confrontation permanente entre les hommes et les femmes, parce que je ne le conçois pas, parce que moi j’adore les femmes et je ne vois pas en quoi ma masculinité et mon hétérosexualité seraient un ennemi de la gent féminine – au contraire !
Vous avez quitté Twitter : pourquoi ?
D’abord parce que j’en ai marre des gens qui donnent leur avis sur tout. On finit par n’en plus pouvoir des avis des uns et des autres, et la forme de Twitter fait qu’on finit très vite par se dire des choses très violentes et de manière très désagréable. Quand je m’aventurais sur des considérations politiques, je prenais des choses très brutales avec la tentation d’en renvoyer aussi. J’en ai eu marre. Et puis avoir la tentation de cliquer sur son nom de temps en temps et de tomber sur des trucs atroces… J’ai gardé Facebook, j’y fais de la promo, je publie des articles, je mets de la musique et des trucs que j’aime bien – et je ne fais plus que ça. J’ai gardé Instagram parce que c’est l’egotrip, tout va bien dans ma vie, mon monde est un miracle permanent, chaque heure qui passe est merveilleuse, team de ouf, spectacle de dingue… C’est inoffensif. Twitter, c’est devenu trop violent pour moi. Et puis j’en ai marre, je ne veux plus donner mon avis. Ma zone de certitude a tendance à se réduire et je n’en peux plus de lire l’avis des cons. Ça me protège. Certes, je suis alors dans un monde imaginaire, mais après tout c’est aussi pour ça que je fais ce métier.

Carte d’identité littéraire
Livre préféré : Tout l’amour du monde de Michel Déon – ce livre-là a décidé d’un certain rapport avec les femmes, d’une élégance, que je n’ai pas toujours eue dans ma vie, mais qui reste un modèle. J’y attache aussi mon histoire avec cet écrivain que j’ai beaucoup aimé et qui a été comme un père – même mieux qu’un père puisque c’était un père choisi.
Film préféré : La Nuit du Chasseur – c’est un film d’acteur, c’est peut-être pour ça. Le seul film de Charles Laughton, par ailleurs immense acteur anglais.
Pièce de théâtre préférée : Jacques et son Maître – c’est une pièce que je souhaite remonter tous les 10 ans. Dans mon Panthéon – et sans me comparer à lui, car je sais de façon douloureuse que je n’arriverai jamais à son niveau – il y a Strehler, qui a remonté Arlequin valet de deux maîtres toute sa vie, comme une façon de comprendre où il en était, de sa vie d’artiste, de sa vie d’homme. J’ai cette même relation avec Jacques.
Compositeur préféré : Mozart, c’est le plus grand
Un grand acteur : Bryan Cox
Un grand metteur en scène : Strehler, il a été mon Dieu vivant, capable de programmer des miracles à heures fixes – ses spectacles, que j’ai vus 4 fois, 5 fois chacun, étaient toujours parfaits.
Un grand réalisateur : Bergman
Une belle citation de théâtre : la fin de Jacques et son Maître : « Je vais vous révéler un grand secret, une astuce immémoriale de l’humanité. En avant, c’est n’importe où. […] Où que vous regardiez, partout, c’est en avant. » Et le maître répond « Alors en avant, mon petit Jacques. »