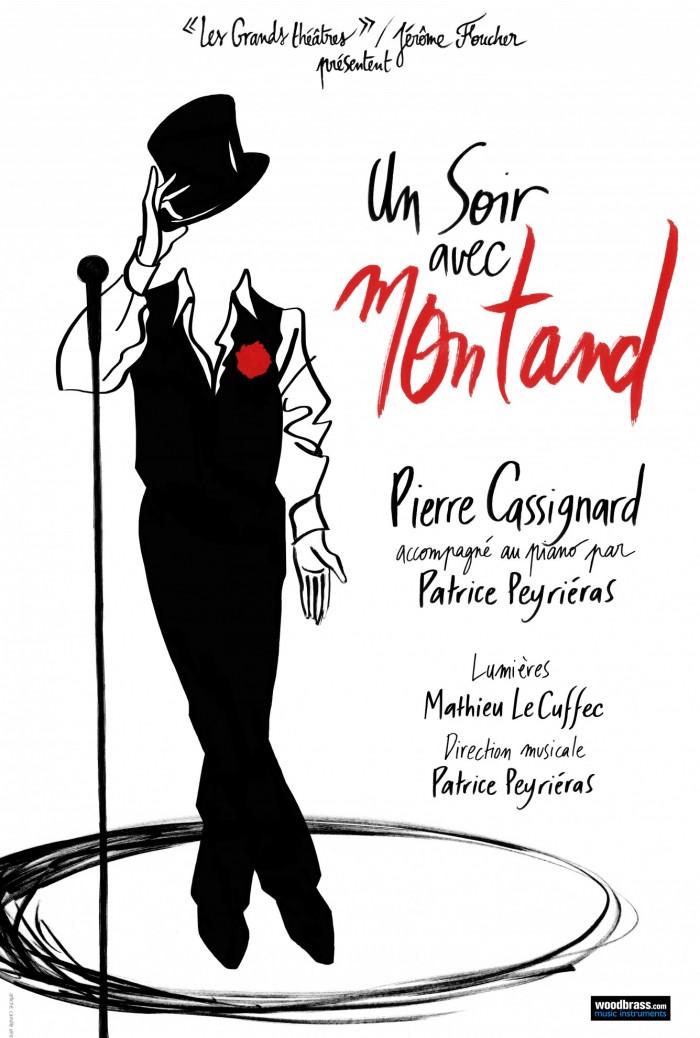Critique de La Règle du Jeu, d’après Renoir, vue le 10 février à la Comédie-Française
Avec Cécile Brune, Sylvia Bergé, Éric Génovèse, Alain Lenglet, Jérôme Pouly, Laurent Natrella, Elsa Lepoivre, Christian Gonon, Julie Sicard, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Gilles David, Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Danièle Lebrun, Jennifer Decker, Elliot Jenicot, Laurent Lafitte, Benjamin Lavernhe, Claire de La Rüe du Can, Didier Sandre, Rebecca Marder, Pauline Clément, Dominique Blanc, et Julien Frison, dans une mise en scène de Christiane Jatahy
Bon. Mettons-nous au point dès la première ligne de cet article : je n’ai encore jamais vu La Règle du Jeu de Renoir et ne prétends à aucun moment en faire une critique. Ici, je vais essayer de poser des mots sur une expérience unique et indescriptible, de rationaliser l’extravagance, de décrire l’impensable. Vous ne saurez pas tant que vous n’y serez pas. Mais je vais essayer. C’est vrai, je n’ai pas vu le film d’où est tiré le spectacle et je m’en moque. Parce que j’ai décidé de manière totalement imprévue de m’y rendre, m’empêchant de préparer ma soirée. Et parce que cette improvisation totale est en accord avec l’atmosphère qui règne dans la salle, je vous avouerai que je m’en fous.
Bien que la pièce soit assez déconstruite, on comprend facilement le propos et à aucun moment on ne se trouve perdu : Robert de la Chesnaye, riche bourgeois, invite de nombreux amis à fêter le retour de André Jurieux parmi eux, après qu’il a sauvé de nombreux migrants en Méditerranée. Si la relation entre André et Christine, la femme de Robert, semble ambiguë, il en va de même pour celle qui lie Robert à Geneviève, une autre invitée. Le monde de la transfiguration s’ouvre alors aux convives : Robert organise une grande fête, imposant à ses invités de se déguiser, de chanter, de danser et de s’amuser. Un spectacle en apparence explosif et joyeux mais dont l’implosion à retardement nous agresse petit à petit.
Pour nous présenter son adaptation, Christiane Jatahy a imaginé un dispositif encore jamais mis en oeuvre dans la Salle Richelieu : les spectateurs vont devenir acteurs de sa propre pièce. L’idée est de nous intégrer au mieux à l’histoire, au décor, au casting. Et pour cela, toutes les barrières sont levées : la notion de 4e mur n’existe plus. Les acteurs jouent dans la salle, avec le public, armés de caméra et jonglant entre théâtre et cinéma. Cela peut choquer au premier abord, mais pourtant dès que le film initial s’installe, plus aucun doute n’est possible : la précision des prises, son timing impeccable, les gestes millimétrés, presque insondables, et qui pourtant transpercent l’écran comme s’ils avaient été hurlés, annoncent la teneur du spectacle qui va suivre. Très vite, on oublie que l’on est au théâtre et qu’on regarde l’écran : lorsque les premiers invités arrivent, j’étais étonnée de ne pas voir une trentaine de convives s’installer sur scène. J’avais oublié la distribution.
J’ai été prise dans la fête, de manière très subtile : ça paraît immédiat et pourtant la transition est là. Lentement, on passe du film initial à la salle, et on se retrouve alors intégré au scénario. Si les premières minutes sont malaisantes, avec cette chasse à courre où les gibiers sont les femmes conviées à la soirée, on se retrouve très vite projeté en plein milieu de la soirée. Et, alors que le malaise était là l’instant d’avant, on est soudainement en train de chanter avec les invités, les bras levés, conquis. Nous sommes comme les autres convives, à rire, à chanter, danser et boire. La fête bat son plein, mais ce n’est qu’une apparence et toute la suite cherchera à nous le montrer. Les scènes finales, où un calme presque inquiétant règne sur le plateau, sont plus cruelles, de par le contraste qu’elle présentent avec ce qui a précédé mais également par l’absurdité des réactions qu’elles proposent : Robert, venant d’apprendre qu’il est trompé, entre dans la salle de fête soudainement désertée à la manière d’un paysage de guerre, le filmant de manière dérisoire et presque triste. L’expérience spectateur proposée lors de ce spectacle est unique : loin de ressentir depuis notre fauteuil l’émotion qui se dégage du plateau, il s’agit ici de vivre, et de vivre pleinement l’action, de prendre part à l’histoire. Suivez mon conseil : sortez de votre zone de confort, oubliez le cadre, lâchez-vous, et il ne s’agira alors plus simplement d’éprouver, mais de consommer à pleines dents cette proposition unique, extravagante, exceptionnelle.

J’ai trouvé le spectacle très porté sur la distinction entre l’être et le paraître, d’une cruauté sans pareille. Certes, on est gai et on chante tous ensemble l’espace d’un instant suspendu. Mais l’instant d’après, notre hôte change du tout au tout. Il aperçoit sa femme qui le trompe et son regard trahit ses pensées. Jamais je n’ai vu pareille colère, pareille tristesse, transparaître ainsi, aussi soudainement, à travers un regard. Un peu malsain, un peu satanique, il est un maître de cérémonie étrange, dérangeant, à l’hospitalité inhabituelle. On connaît l’ampleur du talent de Jérémy Lopez, et une fois encore il parvient à nous surprendre : son effet réside en ce qu’à aucun moment il ne va tricher. Il ne joue pas, c’est à peine s’il incarne ; il est. C’est le même homme qui joue avec son public, le regarde droit dans les yeux et lui lance des punchline, et qui l’instant d’après sera déchiré et trahi par sa femme. Ce sont les mêmes yeux, les mêmes émotions, le même regard. Et la puissance de ce regard réside bien plus en la sensibilité et l’implication de l’homme qu’en la technique de l’acteur.
Tout nous rappelle le fossé qui sépare le monde de la figuration de celui du sentiment vrai. D’abord, par le personnage de Serge Bagdassarian : je sens bien que je me répète, mais il fait partie de nos Grands du Français et sa présence sur ce plateau s’avère absolument incontournable : à travers ses reprises de Paroles, paroles et Non ho l’eta, il souligne à lui seul le côté désabusé et parfois malheureux de telles soirées. Malgré leur présence, ils ne parviennent pas à être ensemble, et cette désillusion présente tout au long du spectacle laisse un goût amer chez le spectateur. On semble s’amuser et pourtant quelque chose dérange. Jérôme Pouly, déchirant lors des scènes finales, emprunte à l’Octave et au Coelio de Musset, et au Cyrano de Rostand. Désenchanté, il met des mots durs sur ce qu’il vient de vivre, et laisse la place à un Laurent Lafitte aux allures de héros de notre siècle. Éric Génovèse, transformé et difficilement reconnaissable, est un Marceau séduisant ; et sa voix, inimitable et douce, qui amène une humanité évidente à son personnage, contraste avec celle de Bakary Sangaré, plus dure, qui se retrouve exclu de cette société qu’il contrôle à l’entrée. Du côté des femmes, on retrouve ce contraste entre Suliane Brahim, Christine fébrile et hors du Jeu, et Elsa Lepoivre, qui semble connaître les règles et jongler avec aussi facilement qu’avec les bouteilles d’alcool.
Ce spectacle, c’est également un travail de troupe absolument dingue. On les voit prendre un pied total, et on n’a parfois qu’une envie : se lever et les rejoindre sur scène. Le pari était risqué et fort, et si les acteurs ne faisaient que leur boulot, jamais cela ne prendrait. Ils sont au-delà de toutes limites, sur un fil si mince que la menace de tomber est présente à chaque réplique. Mais cela, on ne s’en rend compte qu’en sortant du spectacle. Faire des expériences pareilles à la Comédie-Française nécessite culot, courage, et maîtrise absolue. Il fallait oser, ils l’ont fait. Pour l’audace, pour l’enjaillement, pour l’excellence, et bien sûr pour cette soirée, merci. Je reviendrai.
Une expérience théâtrale comme je n’en avais jamais vécu. Incroyable, vivifiante, unique, paralysante. Totale. ♥ ♥ ♥